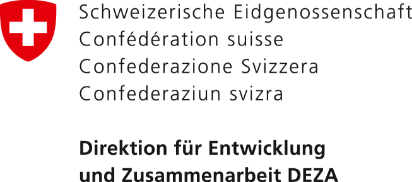«Les femmes sont plus douées pour promouvoir la paix»
Après le drame du génocide rwandais en 1994, le psychologue Simon Gasibirege a mis en place des ateliers de santé mentale communautaire pour apaiser les souffrances et recréer du lien social. Dans cet entretien, il décrit cette approche qui a permis d’insuffler de l’espoir au sein de populations meurtries par des décennies de conflits. Et explique pourquoi les femmes sont particulièrement résilientes.
Dans la région des Grands Lacs africains, les violences sexuelles ont pris une ampleur difficilement imaginable. Pourquoi, dans une communauté, à un moment donné de son histoire, un nombre élevé de ses membres en vient à commettre des actes de viol?
Les viols massifs constituent le dernier degré de haine et de déshumanisation. Les gens ne naissent pas violeurs, avec la haine. Ce sont une stratégie de guerre et une politique d’extermination qui ont conduit à la socialisation de la haine. La colonisation a entraîné la division. Violence et conflits en ont découlé. La femme est devenue l’ennemie désignée. Détruire la femme, c’est détruire la vie. C’est le meilleur moyen de rayer un groupe ethnique.
«La seule forme de guérison pérenne est une guérison partagée.»
Aussi le viol est-il utilisé comme arme de guerre.
Oui, derrière la guerre se trouve une idéologie qui réduit l’autre à un animal et à un objet. Il faut l’éliminer. La violence à l’encontre des femmes s’inscrit dans la logique de cette idéologie.
Quel est le profil du violeur?
C’est un homme qui n’a pas été aimé. Froid, il n’éprouve pas de sentiments. Il en veut à l’humanité entière et va décharger sa haine sur les femmes. Au départ, les leaders ont incité la masse à détruire la femme de l’ennemi pour exterminer le peuple d’une communauté. Aujourd’hui, dans les sociétés où le lien social et le tissu psychosocial ont été détruits, les normes et les valeurs perdues, les criminels opportunistes profitent de la situation pour assouvir leur pouvoir.
Et ils sèment la violence. De quoi souffrent les femmes victimes de viol?
Humiliées, elles ont perdu toute estime d’elles-mêmes et n’ont plus de valeur aux yeux de leur mari. Profondément blessées, elles risquent de blesser les autres. Elles ressentent également une profonde colère, qu’elles déverseront sur leurs enfants, les hommes et les voisins. Ou alors impuissantes, elles chercheront Dieu le Tout-Puissant pour se consoler. Dans la prière toute la journée, elles ne pourront répondre à leurs obligations familiales.
Les violences sexuelles affectent ainsi autant les femmes que leurs familles et les communautés. Pour aider les victimes, vous êtes passé de la consultation individuelle à la thérapie communautaire. Quel a été votre cheminement?
En 1996, alors que j’étais professeur à l’Université nationale du Rwanda, à Butare, au sud du pays, des femmes et des filles venaient me consulter. Elles présentaient des symptômes de stress post-traumatique: pleurs, tristesse, colère, violence, isolement, refus de parler, angoisse, anxiété ou encore envies suicidaires. Certaines étaient complètement déconnectées de la réalité. Les séances individuelles les apaisaient quelques jours, mais, après un moment chez elles, le bien-être disparaissait. Les gens se moquent de nous et nous rejettent, me disaient-elles.
«Détruire la femme, c’est détruire la vie. C’est le meilleur moyen de rayer un groupe ethnique.»
Vous avez donc décidé de travailler avec la communauté.
Dans un contexte marqué par la fragilité collective, la guérison individuelle est perpétuellement remise en cause par les personnes encore blessées, qui vivent avec la survivante. La seule forme de guérison pérenne est une guérison partagée. L’approche psychosociale communautaire est basée sur l’idée que, même si elle est vulnérable, la société possède ses propres ressources et peut surmonter un effondrement lorsque la communication et la solidarité prévalent. Ses membres savent mieux que quiconque comment résoudre leurs problèmes. Tout ce dont elles et ils ont besoin, c’est un cadre d’échange protégé pour partager leurs difficultés et trouver ensemble des solutions.
Pouvez-vous décrire en quelques mots les cinq ateliers que vous avez mis en place?
Le premier permet aux participantes et participants de prendre conscience de leurs blessures et de celles des autres, en développant l’écoute active et l’empathie. Puis les personnes effectuent un travail de deuil, avant d’explorer leurs émotions actuelles en lien avec le passé. Suit un processus de pardon et de réconciliation envers soi-même et les autres pour rétablir des relations saines: le but est de vivre avec les douleurs du passé de manière apaisée et, si possible, sans rancœur envers la personne qui les a blessés en la détachant de son crime. Enfin, chacune et chacun prend des engagements pour sa vie future, avec des objectifs de transformation clairs. Un atelier dure cinq jours, le processus entier deux ans et demi en moyenne.
Les personnes parviennent-elles au pardon? Guérissent-elles véritablement?
C’est un chemin sinueux et complexe. Bien souvent, le poids de la souffrance est si lourd que la victime veut s’en délester et pardonner à son agresseur pour retrouver la paix intérieure. Au terme des ateliers, les personnes peuvent gérer leurs émotions, vivre avec leurs blessures et reconstruire leur vie. Elles s’aident et se soignent mutuellement.
Les femmes en particulier montrent une énergie incroyable. Sont-elles plus résilientes que les hommes?
De par leur cycle menstruel, les femmes sont sans cesse traversées par la vie. Ainsi, elles ne tombent jamais entièrement. Au contraire des hommes qui ont des hormones de combativité: lorsque leur énergie est épuisée, ils doivent se reposer. La résilience est liée au sens de la vie qui nous porte. Par ailleurs, les femmes sont moins réceptives à l’idéologie de ségrégation. Ayant davantage le sens des relations, elles protègent l’art de vivre ensemble. Elles sont plus douées pour promouvoir la paix dans la communauté. Au Rwanda, la reconstruction a été initiée par les femmes. Ce sont elles qui écrivent l’histoire.
SIMON GASIBIREGE est docteur en psychopédagogie. Ancien professeur à l’Université nationale du Rwanda, à Butare, il œuvre depuis 1994 à la recréation des dynamiques communautaires. L’octogénaire a fondé la Life Wounds Healing Association (LIHOWA) qui propose des ateliers de santé mentale communautaire, des pratiques de justice restauratrice ainsi que des ateliers récréatifs pour remettre du lien et de la vie dans des populations ayant vécu l’horreur. Dès 2011, LIHOWA a été invitée par la DDC à expérimenter l’approche psychosociale communautaire également au Burundi et en République démocratique du Congo, affectés eux aussi par les conflits et les violences sexuelles. Actuellement, l’association travaille avec les ONG partenaires de la DDC à la pérennisation du programme psychosocial et de ses réalisations.

Nous nous réjouissons de votre visite! Plus d’informations