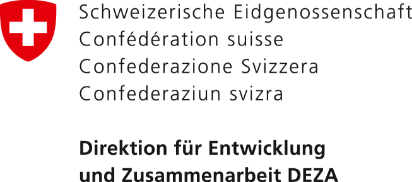«Je voulais redonner une voix à ces figures disparues du Congo»
À travers ses oeuvres, l’auteur congolais Blaise Ndala confronte l’Europe aux zones d’ombre de son rapport au passé colonial. Le Prix Kourouma lui a été décerné en octobre dernier à Genève pour Dans le ventre du Congo, son troisième roman.

Monsieur Ndala, quelques jours avant notre entretien, vous étiez à Genève pour y recevoir un prix et à la Maison de la littérature de Bâle afin de présenter votre dernier ouvrage. Qu’évoque la Suisse pour vous, notamment au regard des thèmes que vous abordez en tant qu’écrivain?
Même si je n’ai jamais pensé spécifiquement à la Suisse au moment de me lancer dans un projet, deux choses me viennent à l’esprit. Tout d’abord, je voudrais signaler que mon dernier roman évoque, entre autres, les œuvres d’art africain qui se trouvent aujourd’hui encore dans les fonds de musées européens. Il y est question des traditions et de l’art du royaume Kuba, une monarchie qui, pendant plus de quatre cents ans, s’étendait sur de vastes territoires de l’actuelle République démocratique du Congo. L’un des personnages du roman, le collectionneur belge Mark de Groof, rapporte de nombreuses œuvres d’art du Congo et constitue une importante collection qu’il écoule auprès de clients européens. On pourrait très bien imaginer que des Suisses aient pu figurer parmi ses clients, alors que de tels objets sont largement représentés dans les institutions helvétiques, notamment au Musée Rietberg de Zurich. Si la Suisse veut se placer du bon côté de l’Histoire, elle ne peut faire l’économie d’une analyse des circonstances de l’acquisition de ces oeuvres ainsi que des possibilités de les restituer au Congo comme à d’autres États africains. D’après ce que j’ai cru comprendre, de premières démarches ont été accomplies dans ce sens.
Et la seconde chose?
Dans mon deuxième roman Sans capote ni kalachnikov, j’interroge nos conceptions de l’aide internationale en général et du travail humanitaire en particulier. Cela devrait sans doute parler à la Suisse, pays qui joue un rôle déterminant en matière de solidarité internationale, puisque c’est ici que le droit international humanitaire a vu le jour. Comme juriste, je sais combien la Suisse s’est investie pour agir en nation généreuse et vertueuse. C’est précisément sur la générosité supposée des États que se penche le roman, sur ce rapport de verticalité entre le Nord avec ses philanthropes et son personnel humanitaire, d’une part, et les populations du Sud, qu’elles soient africaines ou autres, d’autre part. En donnant à voir certaines ambiguïtés de cette verticalité telle qu’elle est pratiquée dans plusieurs régions de l’Afrique, la fiction suggère que, dans certaines circonstances, l’aide offerte peut causer beaucoup de torts. Sous couvert de solidarité et de charité, il n’est pas rare qu’elle profite au bout du compte aux donateurs plutôt qu’aux bénéficiaires supposés. Dans ce contexte, l’argent n’est pas seul en jeu: il y a aussi toute la communication et les images produites et véhiculées sur la misère de ce que nous nommons «les pays pauvres». Il est important que les narratifs que nous nous fabriquons sur l’aide aux plus démunis soient régulièrement remis en question, même lorsqu’ils reposent sur des objectifs des plus louables.
«Comme juriste, je sais combien la Suisse s’est investie pour agir en nation généreuse et vertueuse.»
Quel rôle revient ici aux artistes?
Un roman est là pour poser des questions sur la condition humaine ou pour en faire naître de nouvelles. Loin de prétendre détenir la vérité, le romancier en moi ne fait que constater l’existence de ces représentations problématiques autour de l’Afrique et de l’aide dont elle serait si dépendante. Nous devons soumettre ce que nous lisons, ce que nous entendons ou ce que nous voyons à un examen critique. Ce serait déjà un bon début.
Depuis presque vingt ans, vous sondez le passé colonial de la Belgique dans votre pays d’origine, la République démocratique du Congo. Comment expliquer un intérêt aussi fort?
À vrai dire, tout a commencé par hasard. En 2003, je suis parti en Belgique pour mes études de droit. Une amie belge m’a emmené au Musée royal de l’Afrique centrale, à Tervuren. Elle m’a montré la sépulture de sept des quelque 200 Congolais traînés de force en Belgique à l’occasion de l’Exposition coloniale de 1897, pour y jouer les «sauvages». J’avais déjà lu beaucoup de choses sur l’histoire commune du Congo et de la Belgique, mais ce chapitre m’était totalement inconnu. J’ai alors pris conscience de ma méconnaissance du passé colonial belge dans mon pays. Je voulais en apprendre davantage et découvrais sans cesse des éléments nouveaux. Par exemple, qu’il y avait eu, en 1958, une dernière Exposition coloniale à Bruxelles, au cours de laquelle on avait exhibé à nouveau des Congolais. Ou encore que de nombreuses dépouilles de résistants congolais, emmenés contre leur gré en Belgique à des fins d’études racialistes, s’y trouvaient encore. Ayant accès à toutes les sources en Europe, je me suis plongé dans l’Histoire. Et quand j’en ai suffisamment appris, j’ai voulu redonner une voix à ces figures disparues du Congo.
Quelles ont été vos expériences au cours de cette période de recherche intense?
J’ai été choqué par le peu de connaissances de la plupart des Belges, notamment des universitaires, quant à leur propre histoire. Lorsque j’évoquais les zoos humains, mes collègues étudiants qui, comme moi, se spécialisaient dans le domaine des droits humains, tombaient des nues. Jamais ils n’en avaient entendu parler en cours d’histoire. Aujourd’hui encore, l’image du Congo d’hier dépend fortement de la manière dont la Belgique interprète et communique sur ce passé. Il nous revient, à nous, Congolaises et Congolais, de revisiter cette image. Non pas pour cultiver des ressentiments vis-à-vis de la Belgique, mais pour apporter une perspective historique globale.
Dans ce cas, pourquoi ne pas écrire des ouvrages historiques plutôt que de la fiction?
Il existe beaucoup de livres d’histoire, la connaissance est à portée de main. Mais elle est longtemps restée l’apanage des milieux universitaires, dans une sorte de langage secret. Mon intention n’est pas d’ajouter ma voix à cet univers plus ou moins secret où quelques initiés dialoguent en vase clos. En optant pour une œuvre littéraire, je fais le pari de toucher un public plus large. La fiction et la subjectivité qu’elle induit me permettent de me glisser dans la peau d’un colonisateur belge, d’un roi congolais ou d’un collectionneur, ce qui est le meilleur moyen d’embrasser la complexité d’une histoire qui a tant à révéler selon les différents angles que l’on choisit. Enfin, le roman est un excellent véhicule lorsqu’il s’agit de replacer certains aspects occultés dans le récit dominant. Et, bien entendu, je suis un conteur. C’est une passion que le roman sait honorer.
«pour le peuple Africain, la migration, l’expérience des frontières et le racisme vécu au quotidien en Europe sont, eux aussi, toujours liés au passé colonial ou ressentis comme tels.»
Quel intérêt manifeste la jeunesse congolaise aujourd’hui pour leur propre histoire?
Les thèmes tels que la restitution d’oeuvres d’art africaines ou les dédommagements pour les crimes commis sous la colonisation sont à nouveau plus présents dans la conscience collective. Mais, pour le peuple africain, la migration, l’expérience des frontières et le racisme vécu au quotidien en Europe sont, eux aussi, toujours liés au passé colonial ou ressentis comme tels. Quand la France mène une opération militaire au Sahel ou en Libye, la discussion sur ce passé repart de plus belle. Les jeunes sont nombreux à se mobiliser, notamment grâce aux réseaux sociaux où se déroulent ces débats souvent brûlants.
Percevez-vous des signes de rapprochement entre les pays du Nord et du Sud sur cette question du rapport au passé colonial?
Je crois que nous sommes arrivés à un tournant. L’un des éléments déclencheurs a été le meurtre de George Floyd. Cet acte n’a pu que raviver, pour la nouvelle génération africaine, l’aspiration à plus de justice. Les jeunes luttent contre les effets que la colonisation a sur leur vie, aujourd’hui encore. Les choses commencent à évoluer. En Belgique, une commission d’historiens belges et congolais a été mise sur pied. Sa tâche sera de définir les événements clés devant être intégrés dans le programme scolaire. Le Musée royal de l’Afrique centrale de Tervuren, dont je parlais plus tôt, a été fermé pendant des années. On l’a rénové pour pouvoir y proposer un récit plus global du passé colonial.
«L’aide la plus efficace est celle qui crée les conditions grâce auxquelles elle deviendra superflue.»
Êtes-vous satisfait du résultat?
Le changement n’est pas réussi en tous points, mais une prise de conscience a bien eu lieu: le musée a compris qu’il fallait rompre avec les représentations paternalistes et eurocentrées d’autrefois. Autre exemple: le 30 juin 2020, pour la première fois, le roi Philippe a exprimé ses profonds regrets face aux crimes contre l’humanité perpétrés au Congo par la Belgique, sous Léopold II. C’est un signal politique fort. Il a fallu attendre plus d’un siècle pour cela.
Revenons à la littérature. Quel rôle les organisations de développement telles que la DDC jouent-elles dans la popularisation d’auteurs et autrices africains?
Sans le Prix Kourouma, de nombreuses personnes n’auraient probablement jamais entendu parler de mon dernier livre. À ce titre, des organisations comme la DDC jouent un rôle important dans le rayonnement de nos arts. Comme celui d’autres États du Nord, l’engagement culturel de la Suisse contribue à faire entendre nos voix. Je ne suis pas de ces détracteurs de la coopération au développement qui affirment que tout cela ne sert à rien. Ce serait faire preuve de démagogie. Reste que cette aide devrait avoir pour but de rendre à terme les États africains plus autonomes. Si, aujourd’hui, la Suisse met à disposition les fonds nécessaires pour que Blaise Ndala et Max Lobé se rendent en Afrique et discutent de leurs livres avec des étudiantes et étudiants de Kinshasa ou de Douala, c’est, demain, une institution culturelle locale qui devrait pouvoir s’en charger, pourquoi pas en partenariat avec la Suisse. Coopérer signifie toujours agir ensemble. Soutenir là où cela est nécessaire pour outiller les partenaires qui, la fois suivante, pourront eux-mêmes prendre les choses en main. L’aide la plus efficace est celle qui crée les conditions grâce auxquelles elle deviendra superflue.
Le Salon africain et la DDC
Depuis 2004, la DDC soutient le Salon africain qui se tient chaque année dans le cadre du Salon du livre de Genève. Doté de 5000 francs, le Prix Kourouma y récompense un auteur ou une autrice d’expression française, originaire d’Afrique subsaharienne, pour un ouvrage de fiction. L’écrivain ivoirien Ahmadou Kourouma a révolutionné la littérature africaine dans les années 1970 en intégrant dans ses romans la tradition africaine du conteur. Par son engagement, la DDC entend renforcer la visibilité de la littérature africaine, soutenir la diffusion des oeuvres, encourager les échanges entre écrivaines et écrivains et offrir un appui à leur carrière.
Une dernière question: quels conseils donneriez-vous à de jeunes écrivaines et écrivains africains?
Je ne suis pas nécessairement à l’aise dans le rôle du grand frère qui prodigue des conseils. Comme si j’avais atteint l’Olympe de la littérature pour y trouver le «feu sacré» et acquis un savoir prodigieux. La réalité, c’est que je suis toujours en quête! J’aimerais juste leur dire une chose: le fait qu’ils vivent et créent depuis le Congo, ou dans toute autre région de l’Afrique, ne doit pas les faire douter de l’importance de ce qu’ils ont à dire. L’humanité est la même partout, la parole est la même partout. Nul n’est en mesure de dire mieux qu’eux les conditions de leur existence et le regard qu’ils portent sur le monde. Il faut préserver la passion, ne se laisser bâillonner par personne. Le reste, c’est le temps et les circonstances qui le font.
BLAISE NDALA est né en République démocratique du Congo. Dès son plus jeune âge, il est encouragé à lire par son père, d’où sa grande passion pour l’écriture d’abord, l’histoire ensuite. En 2003, il poursuit ses études de droit en Belgique, puis émigre au Canada en 2007, où il travaille actuellement en tant qu’écrivain et juriste dans le domaine des droits humains, en plus de se consacrer à la littérature. Son premier roman, J’irai danser sur la tombe de Senghor (2014), lui a valu le Prix du livre d’Ottawa dans la catégorie francophone. Une adaptation de cet ouvrage au cinéma par le réalisateur Rachid Bouchareb est en cours. Sans capote ni kalachnikov (2017) a remporté l’édition 2019 du Combat national des livres de Radio-Canada. Dans le ventre du Congo a reçu en 2021 le Prix Kourouma ainsi que le Prix Ivoire, principale distinction littéraire décernée par la Côte d’Ivoire. Il est en lice pour le Prix des 5 continents de la Francophonie. Le roman est édité au Canada et en France, mais aussi en Côte d’Ivoire (aux éditions Vallesse). Grâce à l’édition africaine, Blaise Ndala nourrit l’espoir que ses textes seront plus aisément disponibles sur le continent africain, à un prix abordable.
Nous nous réjouissons de votre visite! Plus d’informations