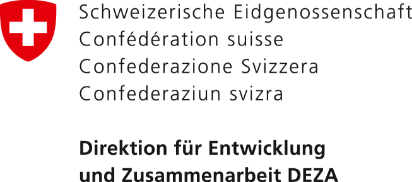Pas de développement durable sans biodiversité
Notre planète observe un recul inquiétant du nombre des espèces et de la richesse des écosystèmes. Depuis plus de trente ans, des États s’efforcent de contrer la destruction croissante de notre environnement via la coopération multilatérale, sans grand succès jusqu’à présent. Un nouveau cadre de référence mondial, doté d’objectifs et d’indicateurs concrets, devrait donner un nouvel élan à la protection et à la restauration de la biodiversité. Pour l’Agenda 2030 et ses 17 Objectifs de développement durable, il représenterait aussi un élément clé.

La Liste rouge des espèces menacées établie par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) constitue un outil de référence en matière de biodiversité mondiale, qui est en péril. L’UICN recense 147'500 espèces d’animaux, de champignons et de plantes, dont plus de 41'000 seraient menacées d’extinction à ce jour.
«Que des espèces disparaissent est normal», indique Bruno Oberle, directeur général de l’UICN. «La Terre n’est pas un musée, elle évolue sans cesse. Toutefois, le rythme est 100 à 1000 fois plus rapide qu’au cours des cent dernières années», relève-t-il. Dès lors, des écosystèmes entiers s’écroulent: en Nouvelle-Zélande, par exemple, les arbres fruitiers n’ont pu être pollinisés, faute d’abeilles. Dans certaines régions d’Afrique ou de Chine, des zones désertiques apparaissent. Selon Bruno Oberle, il en va des écosystèmes comme d’Internet: «Certaines connexions peuvent se rompre sans que le système défaille. Mais, à un moment donné, tout s’effondre.»
Ces moments charnière où entrent en jeu des rétroactions accélérant la destruction de manière incontrôlable sont bien moins connus encore que dans le domaine du climat. «Pour l’humanité, le recul drastique de la biodiversité constitue probablement un risque encore plus grand que la crise climatique, met en garde Bruno Oberle. La plupart d’entre nous ne le perçoivent juste pas encore directement.» Pourtant, les prévisions sont alarmantes: selon un rapport du Conseil mondial de la biodiversité (IPBES) publié en 2019, jusqu’à un million d’espèces animales et végétales seraient menacées d’extinction, dont beaucoup pourraient disparaître dans les prochaines décennies déjà.
Écosystèmes détruits: la pauvreté n’est pas loin
Les raisons de cette hécatombe sont évidentes: d’ordinaire, nul ne doit passer à la caisse pour avoir mis à mal la biodiversité. Au niveau mondial, nous employons tant de ressources qu’une planète et demie serait nécessaire. Si tout le monde consommait autant qu’en Suisse, il en faudrait même trois. Comme pour le climat, les conséquences de la crise de la biodiversité sont inégalement réparties. Les foyers démunis, les familles paysannes et les groupes indigènes du Sud sont le plus durement touchés, même si ce sont eux qui profitent le moins des ressources.
Le constat est donc largement partagé par les expertes et experts en développement: sans protection efficace de la biodiversité, les 17 Objectifs de développement durable de l’Agenda 2030 resteront lettre morte. Pour la plupart, ils dépendent directement d’un environnement sain. Or, si les écosystèmes sont détruits, pauvreté et inégalités ne sont pas loin.
L’inquiétude de l’ONU face au déclin de la biodiversité n’est pas nouvelle. C’est en 1992, à la Conférence sur l’environnement et le développement de Rio de Janeiro au Brésil, que voient le jour tant la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) que la Convention sur la diversité biologique (CDB), principal traité multilatéral en matière de protection de la biodiversité.
Jusqu’ici, 196 pays, dont la Suisse, ont adhéré à ce dernier accord. Les États-Unis l’ont signé, mais jamais ratifié et ne disposent que du statut d’observateur. Les parties s’engagent à protéger la biodiversité sur leur territoire, ainsi qu’à réglementer de manière équitable l’accès aux ressources génétiques et leur utilisation. Elles doivent prendre des mesures pour protéger la biodiversité et assurer une gestion durable de ce patrimoine.
Des objectifs planétaires pour des effets restreints
Formulé en avril 2002, l’objectif de réduire de manière significative le rythme d’appauvrissement de la biodiversité d’ici à 2010 ne sera pas atteint. Un Plan stratégique pour la diversité biologique 2011-2020 à l’échelle mondiale sera adopté en octobre 2010 à Nagoya. Protéger les forêts, freiner la surexploitation des ressources et créer de nouvelles réserves naturelles figurent parmi les 20 Objectifs d’Aichi pour la biodiversité, qui constituent le cœur de ce plan. Il s’agit aussi de restreindre les subventions dommageables et d’intégrer les objectifs en matière de biodiversité aux mesures nationales et locales destinées à favoriser le développement et à réduire la pauvreté. En Suisse, le Conseil fédéral a donc adopté en 2012 une première stratégie nationale dans le domaine de la biodiversité, qui a été concrétisée en 2017 par un plan d’action assorti de mesures.
Le rapport «Perspectives mondiales de la diversité biologique» de 2020 examine les avancées quant aux Objectifs d’Aichi. Le bilan fait l’effet d’une douche froide: sur le plan mondial, aucun des 20 Objectifs n’a été pleinement réalisé et six seulement partiellement atteints. Par ailleurs, seules 23% des visées nationales reflétaient les Objectifs d’Aichi quant à leurs ambitions et à leur ampleur. Un nouveau cadre mondial pour la biodiversité a donc été discuté à Montréal, en décembre dernier, lors de la 15e conférence des Parties à la CDB (voir encadré consacré à la COP15). Deux desseins majeurs s’en dégagent: stopper la perte de biodiversité d’ici à 2030 et garantir une vie «en harmonie avec la nature» à l’horizon 2050.
Un accord mondial pour préserver la biodiversité
Le document final de la Conférence des Nations Unies sur la biodiversité (COP15), qui s’est tenue à Montréal du 7 au 19 décembre 2022, a été considéré comme une avancée importante par les politiques, la société civile et les associations de protection de l’environnement. Les 196 États membres de la Convention sur la diversité biologique ont convenu d’un nouveau cadre mondial comprenant 23 objectifs. Parmi ceux-ci, la préservation de 30% des surfaces terrestres et marines pour la biodiversité d’ici à 2030. Le respect des droits des groupes indigènes est mentionné à plusieurs reprises et leur rôle central dans la protection de la biodiversité souligné. Le texte prévoit également la suppression des subventions nuisibles à l’environnement, notamment dans l’agriculture. Les multinationales devront à l’avenir rendre compte de leur impact sur la biodiversité et des risques économiques liés à son appauvrissement. Un fonds doit, en outre, être créé pour partager les avantages découlant de l’utilisation des informations de séquençage numérique des ressources génétiques. Il permettra d’indemniser les pays du Sud, d’où provient une grande partie de ces ressources. La République démocratique du Congo, l’un des États les plus riches en biodiversité du monde, a néanmoins exprimé son mécontentement, fustigeant le manque d’ambition financière.
Un défi également pour la Suisse
«Les Objectifs d’Aichi étaient bons, mais n’ont pas eu l’impact souhaité, faute de mise en œuvre suffisante», explique Niklaus Wagner, collaborateur scientifique à la Section Conventions de Rio de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV). «Pour ces nouveaux objectifs, il nous faut des indicateurs d’impact uniformisés, de meilleurs comptes rendus et contrôles de la mise en œuvre», précise-t-il. De nouveaux objectifs de biodiversité seraient d’autant plus efficaces s’ils étaient associés à des indicateurs concrets, d’où la nécessité de négocier ces deux éléments conjointement.

Selon Niklaus Wagner, l’un des points clés du nouveau cadre doté d’objectifs mesurables est le plan «30x30»: d’ici à 2030, 30% de la surface terrestre et maritime mondiale doivent être préservés en faveur de la biodiversité, notamment via la constitution de zones protégées, la revitalisation de cours d’eau et le maintien de corridors à faune qui assurent, pour les animaux sauvages, le passage d’un espace de vie à un autre.
Pour la Suisse aussi, la mise en place de cette infrastructure écologique représente un défi. Actuellement, la part des zones protégées avoisine 13,4%. Les conflits d’intérêts sont inévitables: là où de vastes surfaces sont protégées au profit de la biodiversité, une agriculture intensive n’est plus possible. Certains États protestent, au nom de la sécurité alimentaire. Des organisations de la société civile dénoncent, quant à elles, le risque que les populations indigènes vivant dans les zones à protéger dans le cadre du plan «30x30» soient lésées.
Agriculture et biodiversité: un chemin semé d’embûches
L’agriculture et le système alimentaire mondial jouent un rôle central dans la protection de la biodiversité. Quelque 70% de la perte en biodiversité a un lien direct avec la production de denrées alimentaires. Aujourd’hui, 33% des couches arables sur le globe présentent une dégradation, une évolution due essentiellement à la révolution verte et à une agriculture basée sur l’emploi excessif d’engrais et de pesticides. L’exploitation agricole est responsable de 80% de la déforestation mondiale.

La transformation de l’agriculture est dès lors clairement visée par plusieurs des Objectifs d’Aichi. Elle reste pourtant un vœu pieux. «On entend encore des voix prôner l’intensification de l’exploitation agricole sur certaines surfaces pour pouvoir laisser d’autres ‹en friche› et les protéger. Pour nous, cette stratégie est peu durable et antisociale», affirme Simon Degelo, responsable semences et biodiversité chez SWISSAID. «C’est plutôt au sein de l’agriculture même que la biodiversité devrait être préservée et encouragée», souligne-t-il.
Dans le cadre de projets de développement, l’ONG suisse mise par conséquent sur les pratiques agroécologiques. «Les monocultures, souvent basées sur des variétés de céréales hybrides, qui nécessitent beaucoup d’engrais et d’interventions chimiques, ne constituent pas seulement un risque écologique, mais également économique», fait remarquer Simon Degelo. Avec la monoculture, un seul parasite peut anéantir une récolte entière. «En agriculture, la diversité renforce la résilience, aussi face aux chocs climatiques.»
Soutenu par la DDC et le Fonds pour l’environnement mondial (FEM), un projet à Boyacá, dans le nord-est de la Colombie, l’illustre bien. Au cours des dernières années, la production agricole était en chute libre: la culture intensive de pommes de terre avait épuisé les sols, nécessitant toujours plus d’engrais et de pesticides. La population avait alors cherché du travail dans les mines de charbon, apparues illégalement dans des zones protégées.
Dans six communes, SWISSAID a aidé les agricultrices et agriculteurs à planter des variétés anciennes et à préserver la biodiversité dans la région grâce à une utilisation durable des pâturages naturels. Les monocultures de pommes de terre ont cédé la place au maïs, au blé, au quinoa, aux haricots, aux pois, aux lentilles et au chou.
Une telle diversité dans les champs signifie aussi alimentation saine et indépendance vis-à-vis des importations. D’après Simon Degelo, cet exemple montre bien comment la coopération au développement peut contribuer à la réalisation des objectifs en matière de biodiversité.
SWISSAID encourage également les familles paysannes du Sud à constituer des banques et des réseaux de semences. «Pour une agriculture de la diversité, il faut aussi des semences variées, note Simon Degelo. Les agricultrices et agriculteurs devraient avoir le choix, mais, dans de nombreux pays, ce n’est plus le cas.» Les brevets détenus par les multinationales semencières mènent à une privatisation croissante des ressources génétiques, notamment lorsqu’ils portent aussi sur des plantes sélectionnées de manière conventionnelle.
Répartition équitable des bénéfices
Les pays du Sud en particulier cèdent souvent aux États industrialisés et aux grands semenciers. Ils adoptent des législations restrictives, si bien que les semences traditionnelles des agricultrices et agriculteurs disparaissent du marché, poursuit Simon Degelo. Lors des négociations pour un nouveau cadre mondial, le droit des familles paysannes de disposer librement de leurs semences devra donc être protégé.

Autre sujet de discorde: l’accès et le partage des avantages (APA), soit la répartition équitable des bénéfices tirés de l’utilisation des ressources génétiques, comme dans le cas du développement de médicaments à partir d’une plante médicinale. Le Protocole de Nagoya, qui fait partie du mécanisme de la CDB, prévoit que les entreprises, les institutions de recherche et les États conviennent bilatéralement d’une rémunération équitable. Dans les faits, la situation s’avère plus complexe. Selon Simon Degelo, les pays fournisseurs de ressources génétiques ne retirent quasiment aucun bénéfice à ce jour.
Les pays en développement redoutent en outre que la numérisation ne vienne aggraver cette répartition inégale des avantages tirés des ressources génétiques. Actuellement, il suffit souvent que la séquence numérisée du génome d’une plante se trouve dans une banque de données pour que ses caractéristiques puissent être analysées et commercialisées. L’idée d’étendre les règles du Protocole de Nagoya sur l’utilisation de ressources génétiques physiques à des informations de séquençage numériques est loin de faire l’unanimité parmi les États. Selon Berne, il est important que l’accès à ces informations ne soit pas entravé pour la recherche et les innovations futures, précise Niklaus Wagner de l’OFEV: «Dans le cadre des négociations, la Suisse recherche activement des approches praticables, qui répondent aussi aux besoins des pays en développement.»
Jusqu’à présent, la question du financement est restée largement sans réponse lors des négociations internationales. Quelle est la part de responsabilité des différents États dans la crise de la biodiversité, dans quelle mesure participent-ils au financement des mesures de protection? En 2021, le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) a estimé que des investissements de 8100 milliards de dollars seraient nécessaires d’ici à 2050 pour lutter efficacement contre les crises du climat, de la biodiversité et de la disparition des surfaces agricoles, qui sont intimement liées.
«On pourrait croire que c’est beaucoup, commente Bruno Oberle, directeur général de l’UICN, mais cela ne correspond qu’à quelques pour cent du produit intérieur brut mondial.» Ensuite, au rythme actuel d’érosion de la biodiversité, continuer comme si de rien n’était reviendrait bien plus cher à l’humanité. Environ la moitié du PIB dépend directement d’une biodiversité en bonne santé. La production de denrées alimentaires, par exemple, ne peut se passer de pollinisateurs tels que les abeilles. Si ces dernières venaient à disparaître, il n’y aurait plus de récoltes ni de rendements.
Tous concernés
Les États, l’économie, les agences de développement et les fondations: tous sont concernés par les quelque 700 milliards de dollars nécessaires chaque année pour la seule protection de la biodiversité, estime Bruno Oberle. Créé par la Banque mondiale pour financer des projets environnementaux dans les pays en développement, le Fonds pour l’environnement mondial (FEM), dont le renforcement constitue une revendication importante des pays du Sud, participera certes à l’effort, mais ne suffira de loin pas. Selon Bruno Oberle, le principal levier se situe au niveau des collectivités publiques: «Actuellement, 600 à 700 milliards de dollars subventionnent chaque année des pratiques dommageables à la biodiversité», telles que le financement d’engrais chimiques ou le soutien à la production de viande, par exemple. Bruno Oberle en est convaincu: «Si ces fonds étaient investis dans des pratiques régénératrices pour développer la biodiversité, nous pourrions atteindre les objectifs mondiaux en la matière, même si les défis sont colossaux.»
Nous nous réjouissons de votre visite! Plus d’informations